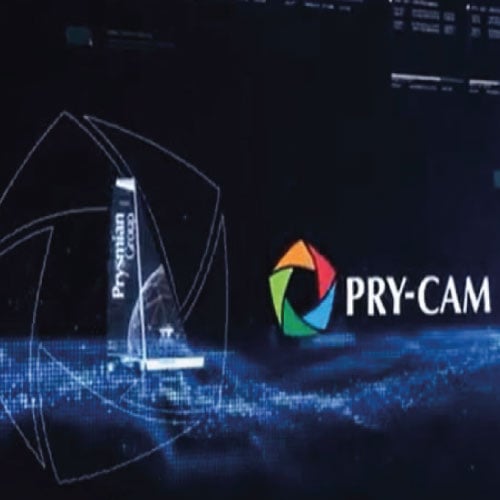Prysmian Ocean Racing
Partenariat voile
Présentation
Le partenariat entre Prysmian Group et Giancarlo Pedote remonte à il y a plus de dix ans.
Ensemble, ils ont remporté des victoires importantes à bord de plusieurs types de bateaux, comme : la deuxième place à la Mini Transat 2013, deux premières places au classement mondial de la catégorie Mini, deux médailles « Champion de France Promotion Course au Large en Solitaire », deux titres de « Marin de l’année » ainsi que la victoire en Multi50 sur la Transat Jacques Vabre en 2015.
En participant au Vendée Globe, Prysmian Group et Giancarlo Pedote relèvent aujourd’hui un nouveau défi qui dépasse celui du sport en devenant ambassadeurs de valeurs positives qui les distinguent sur le plan international.
Courses
Saison 2024 :
- Transat CIC Lorient : 28 avril
- Défi Azimut-Lorient Agglomération : 10- 15 septembre
- Vendée Globe Sables d’Olonne : 10 novembre (départ)